 Il existe une explication très simple à l’attitude du président à l’occasion de la contestation de la réforme des retraites. Il en existe une autre, encore plus simple, à la défection annoncée de Laurent Berger.
Il existe une explication très simple à l’attitude du président à l’occasion de la contestation de la réforme des retraites. Il en existe une autre, encore plus simple, à la défection annoncée de Laurent Berger.
L’art de simplifier peut conduire à se fourvoyer
À l’occasion des manifestations syndicales, les journalistes et les commentateurs ont pour habitude de compter les points obtenus par chaque camp afin de déclarer, en fin de manifestation, qui a gagné et qui a perdu. Il est vrai qu’il est plus facile de commenter un évènement en l’assimilant à un match de tennis plutôt que d’essayer de faire comprendre aux auditeurs/lecteurs les différents enjeux ainsi que les conséquences des décisions diverses qui suivent souvent (mais pas toujours) ces actions.
Deux choses m’ont beaucoup frappé durant toute la période des manifestations provoquées par la réforme des retraites.
La première, c’est que la quasi-majorité des journalistes et commentateurs que j’ai entendus à la radio a pris le parti des manifestants et a critiqué le gouvernement, particulièrement la personne du président. Cette unanimité peut s’expliquer par le fait que les journalistes n’ont eux-mêmes pas du tout envie de travailler deux années de plus. Ou encore par leur désir inavoué, mais bien réel, de ne pas apparaître à contre-courant d’une opinion publique à 70 % défavorable à la réforme proposée.
La deuxième, c’est que l’on n’a pratiquement jamais entendu (à part évidemment les membres du gouvernement), l’expression des 30 % de personnes favorables à la réforme. En fait, j’ai eu l’impression assez désagréable que j’assistais à une entreprise de démolition systématique du projet gouvernemental. Décidément, le peuple français drogué au constructivisme ne supporte plus la libre expression d’opinions divergentes de la doxa ambiante. C’est une déformation inquiétante de la notion de démocratie.
Pour nos journalistes et commentateurs, si la question de la réforme est, espèrent-ils, encore loin d’être réglée, une autre conclusion est entendue : le président n’a rien compris à rien, et il persévère dans l’erreur quand il essaye de faire oublier la question des retraites et de vite passer à d’autres sujets en prétextant que le temps est compté, qu’il n’y a plus à revenir sur une affaire qui a été réglée dans la plus stricte légalité.
Des journalistes qui ne semblent pas avoir compris les ressorts de l’actualité
Un tel manque de jugement sur l’appréciation de la pensée du président est surtout inquiétant par son unanimité. Quoique, s’il est assez habituel que beaucoup se rangent à l’opinion dominante d’un groupe, surtout si cette domination est fortement exprimée, il n’en demeure pas moins qu’accepter sans discussion une affirmation aussi dépourvue de preuve est contraire à la logique. Il est en effet très peu probable qu’une personne capable d’émerger aussi rapidement, et d’accéder finalement à la fonction suprême, soit dépourvue de sens commun.
Après avoir observé Monsieur Macron pendant son premier quinquennat, il semble aussi relativement facile de comprendre qu’il n’est certainement pas homme à se tromper sur la meilleure stratégie à suivre.
Il est certain qu’il apprécie particulièrement la confrontation lors de circonstances tendues et le plaisir de s’extraire sans dommage de situations délicates. Il est aussi évident qu’il possède un don particulier pour évaluer avec justesse les rapports des forces en présence et choisir la voie la plus payante pour lui. Il est donc éminemment curieux d’entendre, jeudi soir dernier, lors de l’émission « Les informés de France Info », un aréopage de fins connaisseurs déclarer à l’unisson qu’il s’était trompé sur toute la ligne.
Reprenons le déroulement des faits.
Les forces syndicales ont organisé des actions revendicatives répétées, popularisées en leur temps par les Gilets jaunes, en comptant que celles-ci porteraient finalement leurs fruits en milliards d’euros, comme ce fut le cas pour ces derniers.
Seulement, il faut aussi tenir compte du fait que le président apprend de ses erreurs et ne les répète jamais.
Peu de manifestants ont réalisé que cette fois leurs actions, pourtant nombreuses et répétées sur le même rythme que celui des Gilets jaunes, avaient eu un effet à peu près nul. Outre le fait d’avoir compris que sortir le porte-monnaie pour résoudre une crise pouvait entraîner des conséquences néfastes selon la conjoncture financière, Emmanuel Macron sait que compenser année après année le déficit du régime des retraites – n’en déplaise à l’attitude rassurante du COR – n’est plus tenable en raison de la remontada impressionnante des taux d’emprunt, consécutive elle-même à une augmentation inquiétante de l’inflation.
 Un simple coup d’œil au calendrier ci-dessus suffit pour expliquer l’urgence pour le gouvernement à montrer aux agences de notation que les difficultés de la France dans la maitrise de sa dette souveraine étaient entendues grâce à ses décisions courageuses et immédiatement appliquées. Pourtant, aucun des journalistes que j’ai entendus n’a fait le rapprochement de la situation de la France avec la promulgation immédiate et nocturne du projet de réforme des retraites après son examen par le Conseil constitutionnel.
Un simple coup d’œil au calendrier ci-dessus suffit pour expliquer l’urgence pour le gouvernement à montrer aux agences de notation que les difficultés de la France dans la maitrise de sa dette souveraine étaient entendues grâce à ses décisions courageuses et immédiatement appliquées. Pourtant, aucun des journalistes que j’ai entendus n’a fait le rapprochement de la situation de la France avec la promulgation immédiate et nocturne du projet de réforme des retraites après son examen par le Conseil constitutionnel.
En réalité, la probabilité pour la France de se trouver dans la même situation que la Grèce il y a quelques années était nettement plus forte que l’écho des slogans récités par des manifestants pourtant nombreux, et le choix de la bonne stratégie était à peu près évident.
Qui gagne perd
Il est maintenant clair qu’après le flux des manifestations viendrait le reflux des manifestants avec leur cortège de questions embarrassantes.
Car enfin, qui les a convaincus d’investir pour certains jusqu’à une bonne douzaine de journées d’action non payées dans un placement qui devait au départ leur procurer deux années de plus de retraite confortable (les deux meilleures) mais qui apparaît de plus en plus totalement utopique ? Ce sont bien les syndicats. Ce sont donc eux qui auront à s’expliquer devant la cohorte impressionnante des manifestants. Les syndicats, unanimement félicités par nos commentateurs pour la conduite exemplaire de leurs mouvements, pourraient bien être finalement les grands perdants de l’aventure, car les réponses qu’ils pourront apporter à leurs adhérents floués seront bien maigres et n’inciteront sans doute ni à de nouvelles adhésions ni à enrayer les défections qui pourraient bien s’ensuivre.
L’auteur des troubles se punit lui-même
Comme je l’ai expliqué dans un article récent, c’est curieusement par l’attitude d’une seule personne que le mouvement de contestation de la réforme des retraites s’est enclenché et a pris les dimensions exceptionnelles observées.
C’est en effet grâce à la position intransigeante de Laurent Berger que la convergence des syndicats a pu s’opérer et que la mayonnaise a pu si bien prendre. Le résultat principal du nombre aussi important de manifestants réunis a été la naissance d’un espoir immense : l’ampleur du mouvement massivement soutenu par une importante majorité, du moins selon ce que les sondages ont mis en lumière, ne pouvait qu’aboutir à une immense victoire. Ou du moins, c’était ce que la plupart des manifestants devaient avoir en tête. La déception va être d’autant plus grande.
Laurent Berger est catholique. Pour cette religion, le péché doit être expié pour être absous. Dit autrement, la faute doit être réparée pour être pardonnée. Comprenant que son attitude rigide a encouragé des millions de personnes dans cette déroute, il a décidé de se priver lui-même d’une position prestigieuse et d’un travail qui le passionne certainement.
Dans mon dernier article, j’avais soulevé l’occurrence possible d’un changement de secrétaire général de la CFDT : à vrai dire, je ne pensais pas que cela arriverait aussi tôt. Décidément, les choses vont très vite en politique…
Sur le Web : Contrepoints
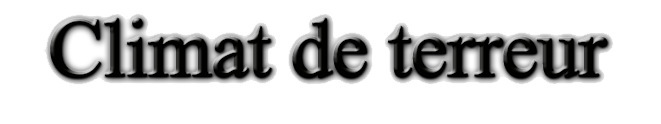

 Aucun commentaire
Aucun commentaire
 on grand-oncle Joseph est né en 1867. Il appartenait à une famille de dix enfants (trois garçons et sept filles) qui vivaient chichement au XIXe siècle sur une pauvre exploitation agricole, dans un village des Alpes du Sud : Saint-Bonnet (aujourd’hui Saint-Bonnet-en-Champsaur), situé dans la vallée du Drac à environ 1000 mètres d’altitude.
on grand-oncle Joseph est né en 1867. Il appartenait à une famille de dix enfants (trois garçons et sept filles) qui vivaient chichement au XIXe siècle sur une pauvre exploitation agricole, dans un village des Alpes du Sud : Saint-Bonnet (aujourd’hui Saint-Bonnet-en-Champsaur), situé dans la vallée du Drac à environ 1000 mètres d’altitude. C’est le Ministre de la Transition Ecologique qui ouvre le ban.
C’est le Ministre de la Transition Ecologique qui ouvre le ban. et de 5,20 tonnes pour la France. (Valeurs 2017). Autrement dit, la France est un bon élève, l’Allemagne un mauvais. Mais les règles européennes fixées pour réduire les émissions ne tiennent pas du tout compte de cet état des choses, puisque on demande à tout le monde de réduire de la même fraction (55 %) les émissions de CO2.
et de 5,20 tonnes pour la France. (Valeurs 2017). Autrement dit, la France est un bon élève, l’Allemagne un mauvais. Mais les règles européennes fixées pour réduire les émissions ne tiennent pas du tout compte de cet état des choses, puisque on demande à tout le monde de réduire de la même fraction (55 %) les émissions de CO2.
